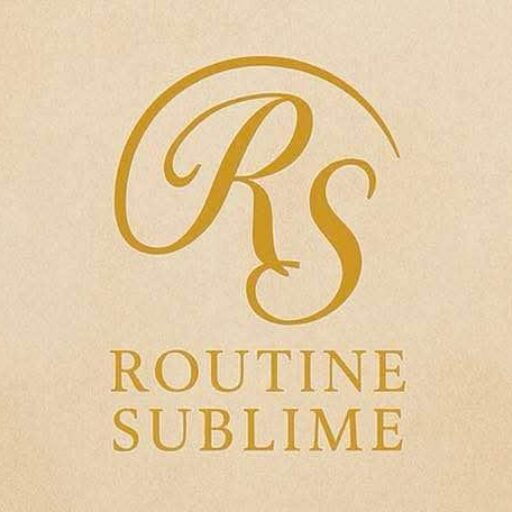Il y a des jours où j’aimerais revenir en arrière… Pas pour tout changer, pas pour effacer quoi que ce soit, mais juste pour me souvenir de ce que c’était… avant. Avant que nos mains ne soient toujours pleines, avant que nos yeux soient happés par un petit rectangle lumineux, avant que nos silences ne soient remplis de notifications.
Je repense souvent à cette époque où le téléphone sonnait dans la maison. Un seul, il trônait dans l’entrée, un peu comme un membre de la famille. On se passait le combiné, on riait, on chuchotait, on raccrochait avec un sourire. Il n’y avait pas de filtres, pas de mises en scène, juste une voix à l’autre bout. Une présence, simple et entière.
Aujourd’hui, ce même objet, ou du moins ce qu’il est devenu, est attaché à nous comme une chaîne invisible. On le garde près du cœur, dans la poche, sur la table, à portée de main. On croit que c’est lui qui nous relie aux autres, alors qu’il nous éloigne doucement de tout ce qui est là, juste là, autour de nous.
Quand j’ai vu cette image, ce téléphone enchaîné à une boule de métal, j’ai ressenti un mélange étrange de tristesse et de vérité. Parce que c’est exactement ça. On croit tenir le monde au bout des doigts, mais c’est lui qui nous retient. Il ne fait pas de bruit, cette chaîne, elle ne grince pas. Elle s’installe doucement, jour après jour, à coups de gestes anodins; un réflexe du pouce, une vérification rapide, un “je regarde juste un instant”. Et sans qu’on s’en aperçoive, nos pensées deviennent fragmentées, nos émotions traversées par mille signaux qui ne nous appartiennent plus.
On ne respire plus dans le même rythme. On ne marche plus sans regarder. On ne s’ennuie plus, alors qu’avant, l’ennui était une porte ouverte vers l’imaginaire. Je ne dis pas qu’il faut tout rejeter. Je dis juste qu’on s’est perdus quelque part, entre les pixels et le besoin d’être vus. On a troqué la liberté contre la connexion, la présence contre la performance. On a oublié que la vraie vie n’a pas besoin de Wi-Fi pour exister.
Il y a quelques années, le silence avait encore sa place. On pouvait marcher longtemps sans être interrompu, s’asseoir dans un café sans ressentir le besoin de vérifier quoi que ce soit. On écoutait le monde, on observait les gens. Il y avait des regards, des hasards, des rencontres qui naissaient du simple fait d’être là, vraiment là. Aujourd’hui, le silence dérange, on le fuit, on le comble. On fait défiler des images pour ne pas sentir le vide. On cherche des mots, des likes, des présences numériques pour oublier la nôtre. Et parfois, le soir, quand tout se calme, on réalise que malgré les centaines de messages, on se sent seul quand même, parce que rien ne remplace la chaleur d’une vraie conversation. Rien ne vaut un regard qui ne juge pas, un sourire qui ne s’efface pas au bout de vingt-quatre heures, une main qu’on serre au lieu d’un cœur qu’on clique.
Je repense souvent à la lenteur d’avant. Les journées semblaient plus longues, les heures plus denses. On ne prenait pas une photo de chaque moment, on le vivait, tout simplement. Le souvenir se formait dans le cœur, pas dans l’appareil. Il restait flou parfois, mais vivant. Aujourd’hui, on immortalise tout… et on oublie plus vite. On ne regarde plus les couchers de soleil, on les capture. On ne savoure plus le repas, on le photographie. On ne s’émerveille plus, on partage. À force de vouloir tout garder, on ne garde plus rien vraiment. Le temps a changé de forme, il s’est accéléré, il s’est vidé. Nos mains glissent, nos regards passent, et les journées s’échappent comme du sable entre les doigts. Et pourtant, au fond, on sait… On sait qu’il suffirait de peu pour ralentir, de beaucoup de courage, peut-être, mais de peu de gestes.
Il y a une beauté immense dans l’idée de poser le téléphone. De le laisser là, sur la table, sans l’éteindre, sans le fuir, simplement ne plus lui appartenir. Sortir marcher sans lui, lire sans être interrompu, regarder quelqu’un sans détourner les yeux. On croit souvent qu’on va manquer quelque chose, mais en réalité, c’est quand on regarde l’écran qu’on manque la vie. Il y a ce moment si rare où le silence revient, où on sent la respiration reprendre sa place… Où on redécouvre la texture du vent, la lumière du matin, la lenteur du café qu’on tient dans la main. Ce moment-là, il ne se capture pas, il se vit. Et c’est peut-être ça, la vraie liberté, pouvoir exister sans témoins.
Je ne veux pas parler de ce monde comme d’une catastrophe. Il y a du beau, aussi, dans ces écrans. Des mots qui réchauffent, des visages qu’on retrouve, des liens qui survivent grâce à eux. Mais je crois qu’il faut apprendre à s’en servir sans s’y perdre. À redevenir les maîtres de ce qu’on regarde. À ne pas laisser la machine nous dire qui on est, ce qu’on doit aimer, ou comment on doit vivre. Il faut se rappeler que ce qu’on voit n’est qu’un fragment, une lumière passagère sur un mur, et que la vraie vie, la nôtre, continue en dehors du cadre, dans les choses qu’on ne poste pas.
Alors peut-être qu’un soi, on pourrait essayer, pas pour toujours, pas en protestation, juste pour respirer un peu. Fermer les yeux et … Se souvenir de la voix d’un ami, de la sensation de la pluie sur la peau, du bruit des pas dans la neige, du rire d’un enfant sans caméra autour. Juste ça. Un soir sans filtre, sans bruit, sans lumière artificielle. Et peut-être qu’on se rendrait compte que la liberté, la vraie, ne tient pas dans une poche. Elle tient dans la manière dont on marche, dans ce qu’on choisit de regarder, dans la paix qu’on retrouve quand on dépose enfin la chaîne.
Il y a des routines qui ne s’écrivent pas dans un agenda, mais dans le calme retrouvé d’un moment sans bruit, sans écran, juste soi: la routine d’esprit.
Tu veux recevoir les prochains articles dès leur parution ?